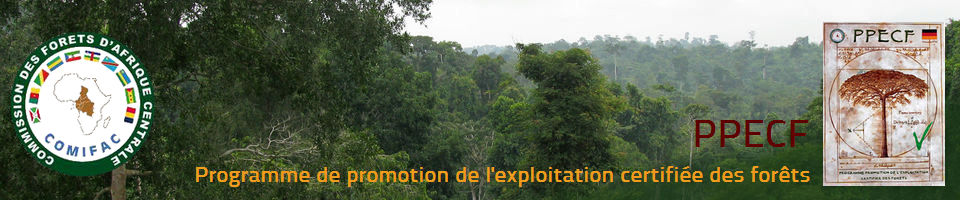Qui sommes-nous ?
Au cours des vingt dernières années, au départ d’une controverse très intense et très médiatique sur l’exploitation des forêts naturelles du bassin du Congo, un processus de certification volontaire a démarré et évolué de façon progressive. A présent, l’appui du PPECF a permis d’augmenter significativement les superficies de forêts certifiées dans le bassin du Congo, pour atteindre aujourd’hui, 6 millions d’ha certifiés "Gestion Responsable" (FSC® ; PAFC-BC) et environ 7 million d'ha "Légalité" (OLB; LS; TLV).
Ainsi, la prise de conscience et surtout l’application des principes d’une exploitation responsable des forêts sont en constante progression : d’une part, les entreprises sont de plus en plus convaincues de l’intérêt économique de produire du bois certifié, les Etats d’Afrique centrale améliorant leur gouvernance forestière et d’autre part, les pays importateurs dont ceux de l’Union européenne qui renforce d’année en année leurs stratégie de lutte contre l’importation de le bois illégal, à travers un nouveau règlement, le RDUE, publié le 9 juin 2023, au Journal Officiel de l’Union Européenne, sous la référence 2023/1115.
L’Union Européenne, par ce texte historique, veut réduire sa contribution à la déforestation et ainsi garantir aux citoyens que les produits qu’ils achètent n’impactent pas les forêts dans le monde.
Cependant, la progression des superficies certifiées dans le bassin du Congo reste lente, sauf au Gabon où une loi de finances incitative en vigueur depuis 2020, a déclenché une dynamique soutenue d’entreprises voulant obtenir, au plus vite une certification.
Ceci s’explique par :
- un contexte défavorable aux opérateurs économiques, lié à des conditions économiques difficiles (crise de 2018, COVID 19, hausse de l’énergie, difficultés logistiques, etc.) qui obèrent la promotion de la gestion durable des ressources naturelles ;
- une société civile encore trop peu organisée, au sein de laquelle, un processus consultatif (groupe d’élaboration des normes) doit constamment veiller à faire évoluer les principes, critères et indicateurs (PCI) des grilles nationales de certification ;
- un socle scientifique insuffisant par manque de données ou par manque de travaux d’analyses, qui empêche encore, l’interprétation de concepts essentiels à la norme FSC®, tels que les forêts à hautes valeurs de conservation (HVC) et la protection de paysages (motion n° 65 de l’assemblée générale du FSC® à Séville - 07 au 14 septembre 2014) ;
- le coût élevé du volet social lié à la certification FSC®, auquel s’ajoute la prise en charge, « de facto », de responsabilités dévolues aux Etats et à leurs services déconcentrés (infrastructures sanitaires, entretien de routes, écoles etc.)
- peu de mesures incitatives (excepté le Gabon), notamment à travers la fiscalité forestière des Etats du bassin du Congo envers les concessionnaires, pour les encourager à des efforts continus de gestion plus performante tant sur le plan industriel que social et environnemental ;
- les coûts liés à la préparation et à la mise en œuvre des plans d’aménagement ainsi qu’ au respect des critères de la certification, trop faiblement répercutés sur les prix de vente des produits certifiés, à l’exception de certains marchés de niche.
Néanmoins, la certification forestière bénéficie toujours de soutiens importants, notamment à travers des coopérations bilatérales (AFD, Coopération Allemande, réseaux d’Ongs) et des acteurs de la filière bois (les syndicats de forestiers nationaux, l’Association internationale des bois tropicaux, ATIBT), des Ongs sociales et environnementales, les premiers metteurs en marchés, etc.).
Dans ce contexte difficile, mais motivant, une première convention BMZ 2015 68 203 (2012-2017) signée le 4 janvier 2012, suivie d’une seconde convention BMZ 2018 67 845, signée en 2017, entre la KFW Bankengruppe et la Commission des forêts d’Afrique centrale COMIFAC vont permettre de soutenir, par la promotion de la certification vérifiée tierce partie, le plan de convergence de la COMIFAC.
Ces deux conventions, dans leur continuité, sont articulées autour de trois axes :
- la mise en place de mécanismes techniques et formels, de conditions institutionnelles propices à la certification, à travers les réseaux d'acteurs privés et publiques ;
- l’amélioration de la qualité de l’exploitation industrielle des forêts par le biais de formations et d’activités spécifiques liées à la certification (domaines industriel, social et environnemental) ;
- le renforcement de la communication sur l’exploitation industrielle durable par:
- - la collecte d’informations scientifiquement fondées pour justifier ou améliorer les approches de la certification ;
- la promotion de la transparence dans l’exploitation certifiée des forêts ;
- l’information du grand public et en particulier les communautés riveraines;
- la recherche du consensus entre les acteurs actifs dans la certification.